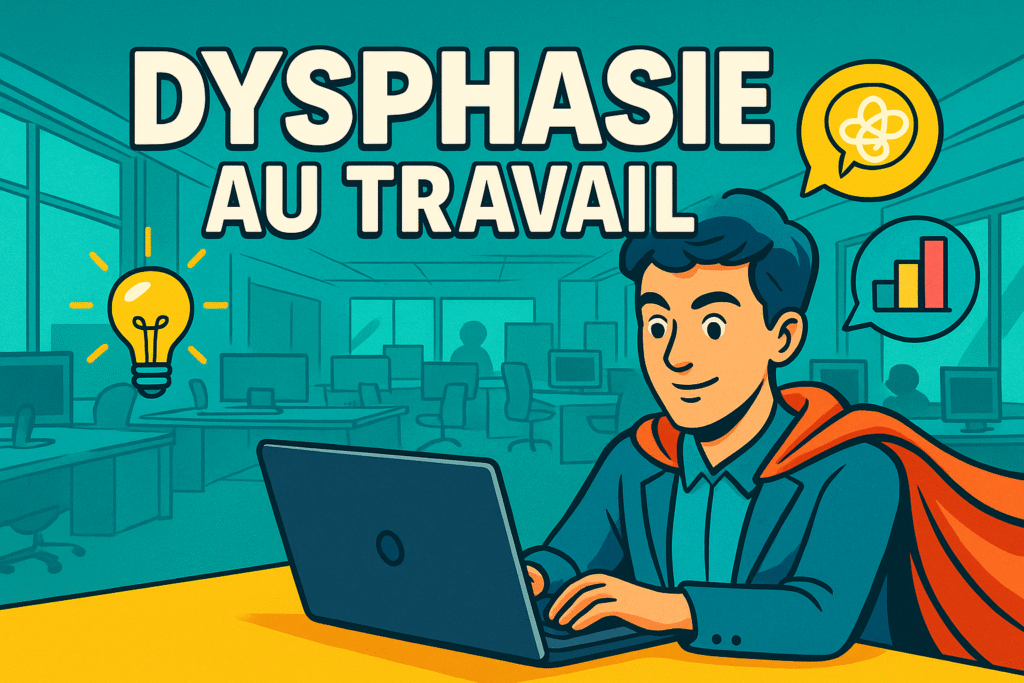
Entrer dans la vie professionnelle avec une dysphasie, c’est un peu comme démarrer une course avec une semelle attachée. On avance, mais pas toujours à la même vitesse, et surtout pas dans les mêmes conditions. Pourtant, de plus en plus d’adultes dysphasiques réussissent à faire leur place dans le monde du travail, grâce à leur persévérance, à des aménagements adaptés, et à un changement de regard des employeurs.
Dans cet article, on fait le point sur les défis spécifiques que pose la dysphasie en entreprise, mais surtout sur les solutions concrètes, les aménagements possibles, et les qualités uniques que ces profils atypiques peuvent apporter à un collectif de travail.
La communication, un obstacle majeur… mais pas infranchissable
Dans la vie professionnelle, la communication est partout : comprendre les consignes de son manager, rédiger un rapport, participer à une réunion, échanger avec des collègues ou des clients… C’est là que la dysphasie, trouble spécifique du développement du langage, peut sérieusement compliquer les choses.
Beaucoup d’adultes dysphasiques ont progressé depuis l’enfance. Leur langage est fonctionnel, mais les séquelles persistent : lenteur à formuler une idée, fautes de syntaxe, vocabulaire restreint ou flou, difficultés à lire ou rédiger des textes complexes, ou encore stress à l’idée de prendre la parole en public.
Jean-Philippe, aujourd’hui ingénieur en aéronautique, témoigne :
« Je ne cache plus ma dysphasie au travail. Mes collègues savent que je préfère envoyer un mail plutôt que parler devant 50 personnes. Je prends un peu plus de temps pour formuler mes idées, mais ça ne m’empêche pas d’être compétent. »
Ce trouble étant invisible, il est parfois mal interprété : on pense que la personne est distraite, lente, peu compétente… alors qu’elle fait face à un défi langagier permanent.
La peur d’en parler : entre discrétion et reconnaissance
Avouer sa dysphasie à un employeur ou à un collègue n’est pas facile. Beaucoup d’adultes redoutent le regard des autres ou une mise à l’écart. Et pourtant, ne rien dire peut être risqué.
Brigitte, Québécoise atteinte de TDL (trouble développemental du langage), explique :
« Le fait que mon handicap soit invisible nuit à mon maintien en emploi, si mon employeur n’est pas sensibilisé. »
Sans explication, les maladresses peuvent être mal comprises. Un compte-rendu peu clair ? On pense à du laxisme. Une consigne mal suivie ? On imagine un manque d’attention. En réalité, c’est la dysphasie qui parle, pas un désintérêt.
La reconnaissance en tant que travailleur handicapé (RQTH) peut faciliter les choses. Elle permet d’officialiser le trouble et d’ouvrir l’accès à des aménagements concrets sans stigmatiser.
Adapter le poste et les échanges : des solutions simples et efficaces
Pas besoin de révolutionner l’organisation pour accueillir un salarié dysphasique. Des petits ajustements suffisent souvent à faire une grande différence.
Voici quelques pistes qui ont fait leurs preuves :
Favoriser les écrits clairs
Plutôt que de multiplier les consignes orales informelles, mieux vaut privilégier les supports écrits : emails, check-lists, compte-rendus. Cela laisse à la personne le temps de lire, relire, reformuler intérieurement.
En réunion, un ordre du jour écrit et une synthèse ensuite sont très utiles. Et si on veut que la personne prenne la parole, lui permettre de préparer en amont aide à lever la pression.
Réduire la pression orale
Les appels téléphoniques impromptus, les questions « à la volée » en open-space, ou les tours de table où chacun doit improviser une prise de parole sont des sources de stress majeures.
Laisser la possibilité de répondre par écrit, ou à l’oral en tête-à-tête, dans un cadre bienveillant, aide beaucoup. Et si une présentation orale est nécessaire, le salarié peut s’appuyer sur des supports visuels (diapos, schémas) pour structurer son propos.
Utiliser les outils numériques
La technologie est un formidable allié pour compenser les difficultés langagières.
- Correcteurs orthographiques intelligents comme Antidote ou Le Robert
- Logiciels de dictée vocale (ex : Dragon Naturally Speaking, ou même Word et Google Docs)
- Applications comme ChatGPT pour aider à reformuler un texte, synthétiser une idée
- Organisation visuelle avec Trello, Notion, Miro pour structurer l’information autrement qu’en mots
L’IA peut même accompagner les prises de parole en générant des bullet points à partir de quelques phrases, ou en simulant un pitch pour s’entraîner.
Adapter les missions
Il ne s’agit pas de limiter la personne, mais d’adapter son environnement pour qu’elle puisse exprimer son potentiel.
Un salarié très bon techniquement mais peu à l’aise à l’oral ? On évitera de lui confier un rôle de commercial. En revanche, il pourra briller sur un poste d’analyste, de développeur, ou de concepteur. Il est même fréquent que les personnes dysphasiques développent des compétences visuelles, analytiques ou créatives remarquables.
« Je fais beaucoup de schémas techniques plutôt que d’écrire des paragraphes. Ça structure ma pensée, et mes collègues trouvent ça plus clair. » – Jean-Philippe
Et si la différence devenait un atout ?
Être dysphasique, c’est aussi avoir appris à contourner les obstacles, à penser autrement, à observer, à écouter les silences. Cela forge des qualités humaines et professionnelles précieuses.
Parmi les atouts souvent rencontrés :
- Persévérance : il faut de la ténacité pour progresser malgré les difficultés
- Pensée visuelle : très utile dans les métiers techniques, créatifs, ou d’analyse
- Empathie : beaucoup développent une écoute fine, un sens aigu des émotions non verbales
- Créativité : en cherchant d’autres voies pour communiquer, ils inventent, imaginent
Valoriser ces compétences, c’est changer de prisme : on ne regarde plus ce que la personne ne peut pas faire, mais ce qu’elle apporte au collectif.
Le rôle de l’employeur : bienveillance et pragmatisme
Un bon manager n’a pas besoin d’être expert des troubles DYS pour agir. Il suffit :
- D’écouter et de faire preuve de curiosité bienveillante
- De s’ajuster : « comment puis-je t’aider à être plus à l’aise dans cette tâche ? »
- De créer un climat où la différence est vue comme une richesse, pas une faiblesse
Certains employeurs vont plus loin, en proposant du coaching ou du mentorat. Un tuteur peut, par exemple, aider le salarié à préparer une réunion, à reformuler ses idées, à progresser en expression écrite ou orale.
Et parfois, l’orthophoniste continue d’accompagner l’adulte, dans une logique de coaching fonctionnel, avec des objectifs très concrets (parler plus clairement au téléphone, structurer une présentation…).
Témoignage inspirant : « Je suis ingénieur et dysphasique »
Jean-Philippe, qu’on suit depuis le début, est un bel exemple de réussite sans renier sa différence.
« J’ai redoublé ma 6e, j’ai été moqué au collège. Mais avec le soutien de mes parents, d’un super prof de français, et de l’orthophonie, j’ai progressé. Aujourd’hui, je suis ingénieur. J’ai des collègues compréhensifs, un manager qui me fait confiance, et des outils pour compenser. Je ne suis pas devenu quelqu’un de bavard, mais j’ai trouvé ma place. »
En conclusion : ouvrir les portes, pas baisser les bras
La dysphasie n’est pas une fatalité professionnelle. C’est un défi, certes, mais un défi surmontable. Avec les bons outils, une reconnaissance du trouble, un peu d’aménagement, et beaucoup d’écoute, les adultes dysphasiques peuvent s’épanouir dans de nombreux métiers.
👉 Et si on apprenait à mieux travailler ensemble, avec toutes nos différences ?



